Qu’est-ce que le maintien de l’autonomie ?
Le maintien de l’autonomie regroupe l’ensemble des actions visant à préserver les capacités physiques, fonctionnelles et cognitives d’une personne, en particulier lorsqu’elle est confrontée à une perte d’autonomie liée à l’âge, à une maladie chronique ou à une situation de fragilité.
Il s’agit de permettre à la personne de continuer à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, marcher, se laver, s’habiller, préparer ses repas…) de façon la plus indépendante possible, et ce, dans un cadre sécurisé et adapté.
L’objectif est de préserver la qualité de vie, l’estime de soi et de limiter le risque de dépendance.
Dans quelles situations parle-t-on de maintien de l’autonomie ?
Quelques exemples :
Personnes âgées en situation de fragilité :
Fatigue chronique, diminution de la force musculaire, troubles de l’équilibre ou de la mémoire…
Avec l’âge, de nombreuses personnes voient leurs capacités physiques diminuer progressivement. Cette perte fonctionnelle peut entraîner un risque accru de chutes, une limitation des déplacements et une perte de confiance. Un accompagnement précoce permet de ralentir cette évolution et d’éviter l’isolement.

Pathologies neurologiques et chroniques :
Maladie de Parkinson, AVC, BPCO, troubles cognitifs, arthrose. . .
Ces maladies, fréquentes chez les personnes âgées, affectent progressivement la mobilité, l’équilibre, la coordination, ou la mémoire. La prise en charge vise alors à maintenir les capacités restantes, à prévenir les chutes et à améliorer la qualité de vie.

Suites d’hospitalisation ou de maladie aiguë :
Fractures, infections sévères, hospitalisation prolongée. . .
Un séjour hospitalier peut avoir des conséquences importantes sur l’autonomie, surtout chez les personnes âgées. Alitement prolongé, déconditionnement physique, troubles de l’orientation… Ces facteurs entraînent une perte des fonctions motrices et une difficulté à reprendre les activités quotidiennes.
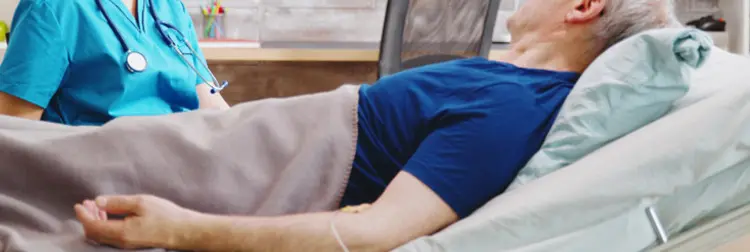
Qu’est-ce que le maintien de l’autonomie ?
Le maintien de l’autonomie regroupe l’ensemble des actions visant à préserver les capacités physiques, fonctionnelles et cognitives d’une personne, en particulier lorsqu’elle est confrontée à une perte d’autonomie liée à l’âge, à une maladie chronique ou à une situation de fragilité.
Il s’agit de permettre à la personne de continuer à réaliser les actes essentiels de la vie quotidienne (se lever, marcher, se laver, s’habiller, préparer ses repas…) de façon la plus indépendante possible, et ce, dans un cadre sécurisé et adapté.
L’objectif est de préserver la qualité de vie, l’estime de soi et de limiter le risque de dépendance.
Dans quelles situations parle-t-on de maintien de l’autonomie ?
Quelques exemples :
Personnes âgées en situation de fragilité :
Fatigue chronique, diminution de la force musculaire, troubles de l’équilibre ou de la mémoire…
Avec l’âge, de nombreuses personnes voient leurs capacités physiques diminuer progressivement. Cette perte fonctionnelle peut entraîner un risque accru de chutes, une limitation des déplacements et une perte de confiance. Un accompagnement précoce permet de ralentir cette évolution et d’éviter l’isolement.

Pathologies neurologiques et chroniques :
Maladie de Parkinson, AVC, BPCO, troubles cognitifs, arthrose. . .
Ces maladies, fréquentes chez les personnes âgées, affectent progressivement la mobilité, l’équilibre, la coordination, ou la mémoire. La prise en charge vise alors à maintenir les capacités restantes, à prévenir les chutes et à améliorer la qualité de vie.

Suites d’hospitalisation ou de maladie aiguë :
Fractures, infections sévères, hospitalisation prolongée. . .
Un séjour hospitalier peut avoir des conséquences importantes sur l’autonomie, surtout chez les personnes âgées. Alitement prolongé, déconditionnement physique, troubles de l’orientation… Ces facteurs entraînent une perte des fonctions motrices et une difficulté à reprendre les activités quotidiennes.
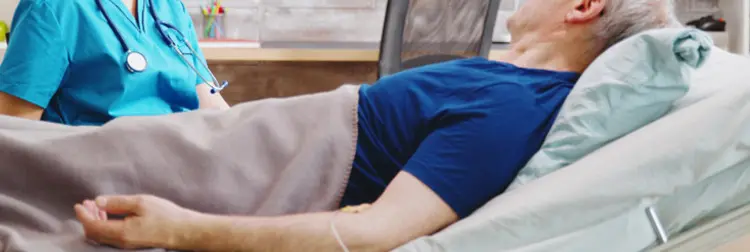
Quel est le rôle du kinésithérapeute dans le maintien de l’autonomie ?
Le kinésithérapeute intervient en prévention ou en rééducation auprès des personnes en perte d’autonomie. Son rôle est d’évaluer les capacités motrices, l’équilibre, la coordination et les gestes de la vie quotidienne.
Il met en place un programme individualisé, basé sur :
- Des exercices de renforcement musculaire doux pour maintenir la force.
- Des exercices d’équilibre et de coordination pour prévenir les chutes.
- Des mobilisations articulaires pour préserver l’amplitude des mouvements.
- Un travail sur la marche, les transferts et les déplacements sécurisés.
Le kiné peut également conseiller sur l’aménagement du domicile, les aides techniques (déambulateur, canne…), et sensibiliser le patient aux bons gestes.
Un des objectifs est également de redonner confiance au patient et de l’encourager à rester actif dans son environnement quotidien.
Pourquoi une prise en charge à domicile ?
Lorsque les déplacements deviennent difficiles, la kinésithérapie à domicile est une solution précieuse. Elle permet :
-
D’intervenir précocement, avant que la perte d’autonomie ne s’aggrave.
- De limiter la fatigue, le stress et les risques liés aux transports.
- D’adapter les exercices et les conseils au cadre réel de vie du patient.
- De travailler dans un environnement familier, ce qui favorise l’engagement et la motivation.
-
De prévenir l’isolement, en conservant un lien humain régulier avec les soignants.
Cette approche individualisée permet au patient de rester acteur de sa santé, dans un cadre rassurant et adapté à ses besoins .